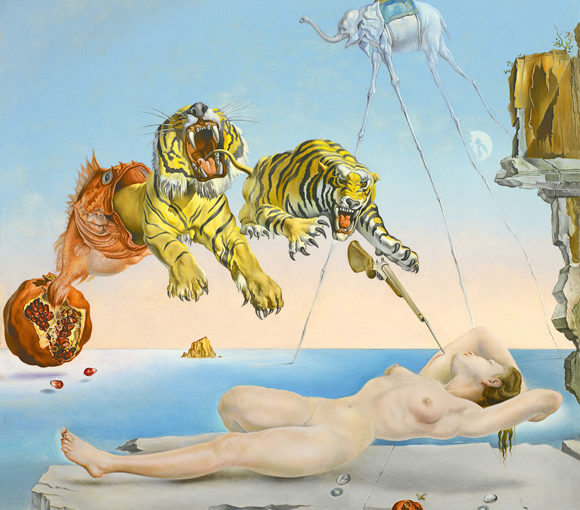L’art une drogue légale, s’interroge Fabrice Bousteau (BA magazine) ? L’art rend-il heureux ? (Anne Cantin – Arts magazine) La réponse paraît évidente. Les artistes non reconnus, les marchands d’art ruinés, les collectionneurs obsédés, les musées déserts, vus des coulisses ne semblent pas refléter cette béatitude. Côté public, l’engouement constaté pour les expositions dans ces 20 et 21 e siècles semble une évidence. Est-ce un effet de mode où une prise de conscience, qu’il faut s’immerger dans l’art, le partager, le mettre aux programmes scolaires, afin d’aboutir à une vision humaniste de la culture. Les émotions qu’il procure, le sens qu’il peut donner à une vie, sont autant de vertus stimulantes qui devraient être inscrites dans les droits de l’homme ou du moins prescrites par la faculté (de médecine…) afin de mieux préserver nos facultés (mentales).
J’en avais rêvé, la Filature l’a réalisée : l’exposition de deux pointures de l’histoire de l’art dans les domaine précis de l’art vidéo et de la photographie, qui de surcroît habitent notre belle région : l’Alsace. Nous allons de surprise en contentement, car Patrick Bailly Maître Grand – PBMG, expose conjointement avec sa moitié,
Laurence Demaison. Le couple est uni autant par l’argentique que par les liens du mariage. Quant au travail de cette moitié, il justifierait un « entier » par sa recherche, son ingéniosité, sa virtuosité.

Nos trois « stars » dont les liens évidents sont la poésie, l’invisible, la métaphore du temps, mais aussi l’étrangeté sont commentées elles aussi par des pointures : pour Laurence Demaison et PBMG, Muriel Berthou-Crestey, dont les titres de docteur en esthétique, critique d’art et chercheuse, indiquent immédiatement la haute tenue de la conférence d’avant le vernissage du 2 novembre 2011.
Extrait du Carnet à Facette : à lire ici titre du blog de Muriel Berthou-Crestey
Robert Cahen, présenté, pas son ami écrivain, Stephan Audeguy , auteur de nombreux ouvrages dont la « Théorie des nuages » et le dernier sorti : Rom@, comme proustien et baudelairien, dans sa recherche du temps qu’il ne perd pas en tentant de l’arrêter, présenté dans les nombreuses conférences, données à l’occasion de la rétrospective de ses films et vidéos en 2010 au Jeu de Paume à Paris, puis à Strasbourg, lors de la sortie du
coffret par Ecart Production en 2010 qui donne une vision de sa production de
films et vidéos entre 1973 et 2007, de son court métrage sur Pierre Boulez « les Maîtres du Temps » , au Fresnoy. Stephan Audeguy a eu le privilège d’être pensionnaire (intra muros) de la Villa Médicis à Rome, comme RKN (hors les murs),
Un autre texte écrit par Hou Hanru, critique d’art, actuel commissaire de la biennale de Lyon, commissaire d’exposition né en Chine, de nationalité française, Chevalier des Arts et des Lettres, dont le mot d’ordre est : multiculturalisme, mondialisation et pluridisciplinarité de la scène artistique, dans le livret qui accompagne le coffret du DVD et CD.
Toutes ces festivités étant chapeautées par Anne Immelé photographe, docteur en Art, professeur à l’Ecole du Quai, École supérieure d’art de Mulhouse et à l’Université Marc Bloch de Strasbourg.
Que dire après que toutes ces sommités se soient exprimées, que la presse se soit fait largement écho de l’événement ?
Ma rencontre avec Patrick Bailly Maître Grand, que je me permets d’appeler familièrement PBMG :

Patrick Bailly-Maître-Grand , nous a accueillis dans son atelier de Strasbourg, un samedi de mars 2007. Ce fut un après midi de grâce. Il nous permit de suivre quelques-unes des innombrables pistes qu’il emprunte et explore depuis plusieurs années, avec une égale passion et une curiosité sans failles. D’emblée nous sommes fascinés par ses petites vanités, ses natures mortes. Il explore les procédés anciens et fait fi de l’aventure du numérique, qu’il trouve sans véritable imagination, ne permettant pas une réelle aventure et un enrichissement intellectuel.
Chaque matin dit-il avec malice, il a la chance de se réveiller avec une idée de sujet, qu’il s’ingénie à mener à son terme, en y consacrant toute son énergie, son temps, sa « débrouillardise » On a l’impression que son imagination est sans limites, à l’instar de ses grandes photos « les fourmis ».
Il nous raconte les réalisations de quelques unes de ses œuvres sans jamais dévoiler le « secret ». Son œuvre est multiple, astucieuse, ironique. On est presque saisi de vertige devant tant d’inventivité et de beauté pure. Inlassablement il nous montre les nippones d’eau, les digiphales, le virage, le rayogramme ou photogramme, les anneaux d’eau, les poussières d’eau, les verres d’eau, le vase, l’éclipse de 99 dans une tasse de café,

les Véroniques, les Maximilennes, Sirius, le hasard et la nécessité, le pâté d’alouettes, les gemelles, les comas, la mélancolie, son autoportrait en vampire. Sur son site en lien sur mon blog, vous pouvez retrouver toutes les photos,
Nous tombons tous en amour devant Endroit en verre, j’en oublie beaucoup. Il nous fait une démonstration rapide de la caméra oscura. Je commence à gamberger devant les herbes….
Pendant des mois, les herbes de PBMG ont hanté mon imagination, je les voyais chez moi, sur mon mur blanc, zen, propices à la réflexion calme. Mais il me fallait créer un cadre digne de les acquérir. Un beau jour c’est arrivé, j’ai réussi à convaincre ma moitié d’aller à la rencontre de PBMG, d’acquérir enfin les Herbes convoitées.
Depuis je les salue au quotidien, je recherche les détails, les petites bestioles prises dans le faisceau du rayogramme. Quand mon moral est en baisse, il me suffit de les regarder pour que le calme et la sérénité m’inondent. Son oeuvre s’est continuée toujours aussi inventive et mystérieuse, montrant une intelligence du regard.
Magicien de la photographie, Patrick Bailly est un Grand Maître. Jamais patronyme n’a été si bien porté.
PBMG de souligner la phrase de Walter Benjamin et son analyse de l’image photographique et de souscrire à la phrase d’un photographe américain, Harry Callahan :
« je photographie les choses pour voir à quoi elles ressemblent une fois que je les ai photgraphiées »
raisonnement qu’il considère unique de ce qu’est une photographie, un éclairage du regard.
La conférencière a cité Janus avec à propos, je lui préfère l’orchidée de PBMG (photo ) de vœux de bonne année, sa signification fortement érotique, sa grande richesse d’expression, sa merveilleuse fantaisie qui la caractérise est le symbole du désir d’amour et de plaisir. Sa zygomorphie m’offre une opportunité que je saisis avec plaisir pour vous parler de Laurence Demaison.

D’après ses photographies et son catalogue, je la voyais très grande et blonde, mais à ma grande surprise elle est plutôt grande certes mais brune. Telle l’omniprésente Cindy Sherman, elle se transforme, se travestit, avec des perruques, des vêtements, des masques, le visage et le corps ensanglantés, quelques fois gore, le rêve de presque toutes les femmes, d’être toutes les femmes, chaque fois une autre, tout en étant la même. Le travail photographique de Laurence Demaison est exclusivement constitué d’autoportraits (sauf les séries « Radiopthérapie » et « Si j’avais su »).

Les techniques utilisées – prise de vue, développement, tirage – sont argentiques et réalisées par l’auteur. Aucune manipulation particulière n’intervient au-delà de la prise de vue (sauf inversion chimique des films pour certaines séries)
Son travail orienté sur son corps, sur sa nudité où se mêlent érotisme, mystère, féminité, désir de choquer, réminiscences d’enfance, autobiographie ? C’est à elle de répondre, invisible, tout en étant visible et lisible ? Ne dit-on pas que chaque artiste dans son œuvre fait son autoportrait, alors Laurence Demaison qui êtes-vous réellement ?
Photographies, dessins et peintures, tantôt superposés, tous les possibles lui appartiennent.
Robert Cahen

« C’est en regardant longtemps de l’eau tomber, et en écoutant le bruit de sa chute, que le temps semble s’arrêter ».
Robert Cahen
La vidéo est dans une certaine mesure comparable à une lanterne magique, objet proustien grâce auquel l’enfant qui est en l’homme peut projeter des images sur les murs de sa chambre, se raconter des histoires pour échapper au temps ; mais l’artiste, lui, connaît le secret du monde, et les vidéos de Robert Cahen le révèlent comme les derniers mots de : À la recherche du temps perdu
Stephan Audeguy
Robert Cahen, rebaptisé sans son autorisation RKN, le monde entier connaît sa haute silhouette vêtue de noir, boucles devenues blanches, yeux bleus au regard soutenu, à la démarche virevoltante, voire flottante. RKN à l’image de certains oiseaux migrateurs qui voguent d’un continent, l’autre, à la rencontre de la beauté et de la poésie du monde, qui sont au cœur du travail de RKN. Mais qu’est-ce qui fait courir RKN ?
Il n’est jamais à court d’idées, un projet à Macao juxtapose un autre en Colombie.

Du pôle nord, à l’équateur, en passant par l’Asie, les Etats Unis, l’Europe, l’Alsace, aux antipodes du monde, tout l’intéresse. Les traces de ses envolées sont visibles. Son œuvre vidéo est là pour nous montrer ses voyages et la réalité qu’il en extrait. Dans ses nombreux voyages, il regarde défiler, le paysage, les gens. C’est ainsi que l’on croit percevoir, des souvenirs d’enfance, de vie d’adultes de tous âges, de toutes nationalités, avec une préférence pour l’Asie, des références cinématographiques à Hitchcock teintées d’érotisme, de fétichisme. Ce sont des rencontres, des apparitions, des disparitions, qui évoquent le passage éphémère des choses et du temps. Ce temps suspendu, étiré, proustien dixit Stephan Audeguy, saturnien, onirique, où les personnages effectuent des passages, pour devenir flou avant de disparaître.
Les images sont musicales, les sons qui les accompagnent sont une évidence, le compositeur de musique concrète a rejoint l’œil du cinéaste, non pas comme dans un documentaire, mais dans un conte de souvenirs, une invitation à voir et regarder les choses, la beauté du monde, par le prisme du poète.
Dans un temps ralenti, arrêté, pour mieux voir et en même temps nous faire toucher du regard, sinon de la conscience de l’éphémère de la vie. De l’eau qui coule, des corps qui flottent, comme le temps, la vie qui s’écoulent de façon immuable. Par cela même c’est une évocation constante de la mort, voire d’êtres chers disparus.
Contempler, pour en extraire les grâces, il a inventé un rapport à la beauté du monde. Affinité touchante avec les estampes, un désir de rendre au monde sa réalité, un rapport au temps et à l’éternité, tout en nous emmenant dans son voyage dans l’imaginaire.
C’est un personnage touchant, aux rêves communicatifs, ses amis du monde entier peuvent témoigner de sa curiosité, de sa cordialité, de son amabilité, et de son ouverture au monde, dans la conception de Hou Hanru, du multiculturalisme, de la mondialisation passive et de sa théorie :
« La force des artistes réside avant tout dans leur capacité à bousculer les concepts de frontières, de fermeture », « L’art est, par définition, synonyme d’ouverture et de main tendue », si simples et si terribles : tout est dans le temps. »
Hou Hanru.
Photos 1 et 2 Site de PBMG
autres photos et vidéos de l’auteur
clic sur les photos pour les agrandir
Partager la publication "Laurence Demaison – Patrick Bailly Maître Grand – Robert Cahen"