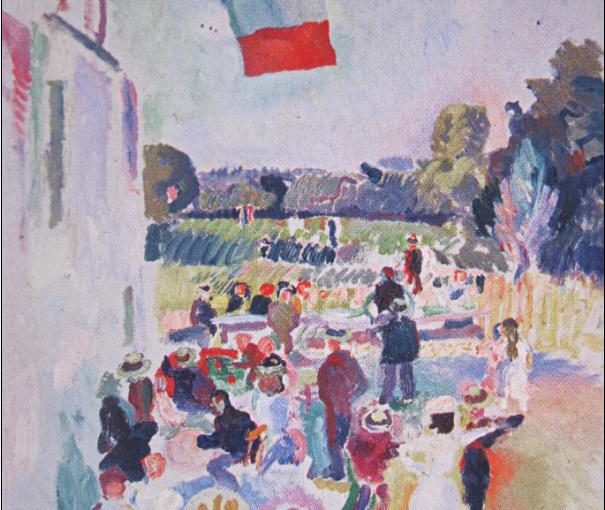À l’occasion du centenaire de la naissance de Louise Bourgeois (25.12.1911 – 31.5.2010)
la Fondation Beyeler rend hommage à l’une des personnalités artistiques les plus remarquables et des plus influentes de notre temps.

Louise Bourgeois, d’origine française, qui s’installa à New York en 1938, est devenue en quelques années un cas particulier dans l’histoire de l’art, référence majeure de l’art moderne et contemporain par son œuvre polymorphe.
Artiste aujourd’hui parmi les plus admirées, elle fut reconnue à près de soixante-dix ans. C’est selon elle, cette reconnaissance tardive qui lui permit de travailler en toute tranquillité. De ce fait elle échappe à tous les courants esthétiques : le surréalisme, l’expressionnisme abstrait, l’art conceptuel – elle ne s’est laissée séduire par aucun d’eux, et est restée rétive à toute classification. Se méfiant des concepts et théories, c’est sur son roman familial, sur sa sensibilité de femme et sur « le paradis de l’enfance », qu’elle s’appuya pour réaliser son travail. Quel que soit le mode d’expression employé, le moteur de son art réside dans l’exorcisme des traumatismes d’enfance, influencé par sa position singulière entre deux mondes, entre deux langues, entre le féminin et le masculin, ordre et chaos, organique et géométrique.
Sa sculpture hybride, témoigne de ce va-et- vient entre deux pôles opposés, de ce dédoublement.
En allant au plus profond de son inconscient, LB rejoint les mythes universels, donnant une version à la fois obscène et dionysiaque de la figure maternelle.
C’est aussi son rapport au père, qui introduisit sa maîtresse Sadie, une jeune gouvernante anglaise, dans la maison familiale, la mère consentante (avait-elle un autre choix ?), s’enferma dans le silence. Ils vécurent ainsi pendant une dizaine d’années. L.Bourgeois parle de cette expérience comme d’une « trahison », qui fut également la faille d’où surgissent la rage et la source créatrice. Si cela se passait dans les années trente à Paris, ce ne fut qu’en 1982 que Louise en parla et mit cette histoire en rapport avec l’œuvre, avec ses peurs et son besoin de « réparer » par la sculpture.

Cette exposition présente environ 20 pièces, pour certaines en plusieurs parties, offrant un condensé de l’oeuvre de Bourgeois qui rend compte des thèmes centraux de sa création : son intérêt pour d’autres artistes, son rapport conflictuel avec sa propre biographie et sa volonté de traduire des émotions dans des créations artistiques. Parallèlement à des oeuvres et à des séries conservées dans des musées internationaux de renom et de grandes collections particulières, on pourra découvrir de nouveaux travaux – dont le cycle tardif À l’infini (2008) – qui n’ont encore jamais été montrés. Des ensembles d’oeuvres issues de la Collection Beyeler leur viennent en résonance. La rencontre avec les toiles de Fernand Léger et de Francis Bacon est particulièrement enrichissante, tout comme la juxtaposition avec les sculptures d’Alberto Giacometti. Ces artistes, avec lesquels Louise Bourgeois a entretenu une relation spéciale, ont été pour elle des présences marquantes et stimulantes. Mais aussi la juxtaposition avec la femme de Cézanne et un paysage de van Gogh.
À l’infini – Alberto Giacometti L’homme qui marche

Sur 14 gravures de grand format, Louise Bourgeois a donné libre cours à son imagination graphique à l’aide de couleur, de mine de plomb et d’ajouts de papier. Comme presque toutes ses œuvres, À l’infini est une sorte d’autoportrait constitué d’émotions devenues images, ou de fragments d’inconscient qui ont pris forme. Dans le thème de cette série d’aspect très poétique consacrée au principe de la vie humaine formée d’un nombre infini de configurations de rencontre analogues mais jamais identiques, les enchevêtrement de lignes d’À l’infini se rapprochent des sculptures de Giacometti. Les efforts que ce dernier fit toute sa vie durant pour représenter la complexité du mouvement, pour le concevoir comme une succession d’immobilités, ainsi que ses tentatives pour représenter la réalité essentielle d’un être humain par ses portraits travaillés de manière exhaustive, relèvent d’une prise de possession qui se rapproche de la conception de Louise Bourgeois.
L’accrochage dans cette salle est absolument remarquable, le choix des sculptures de Giacometti est à saluer.

Maman
Dans le parc de Beyeler, la sculpture de bronze est moins impressionnante qu’aux Tuileries, où elle se dressait fascinante et menaçante, elle semble protégée par les arbres. Après la Tate Modern de Londres (2000/2007) au Jardin des Tuileries de Paris (2007/2008), au Guggenheim Museum de Bilbao (depuis 2001) et à l’Ermitage de Saint-Pétersbourg (2001,) cette sculpture a suscité l’enthousiasme du public et a attiré beaucoup de monde. Maman est montrée en Suisse pour la première fois, Genève, Zurich, Berne, Bâle,
La statue de Louise Bourgeois représentant une araignée monumentale et intitulée Maman (927,1 x 891,5 x 1023,6 cm) est une œuvre-clé pour la compréhension de son oeuvre : il s’agit d’une part d’un hommage à la mère de l’artiste, restauratrice de tapisseries à Paris et qui ne cessait, telle l’araignée, de réparer ses toiles. Louise Bourgeois voit d’autre part dans l’araignée un symbole suprême de l’histoire infinie de la vie, dont le principe est de se renouveler constamment : ce qui est tout aussi réconfortant qu’inquiétant, car il n’existe aucune échappatoire à ce cycle éternel. Maman de Louise Bourgeois constitue donc un monument commémoratif grandiose à l’existence du changement.
The Blind Leading the Blind vs. Barnett Newman Uriel
La version de The Blind Leading the Blind présentée à la Fondation Beyeler date de 1947-1949. Constituée de cales de bois grandeur nature, peintes en noir et en rouge, elle présente une remarquable irrégularité régulière : irrégulière parce qu’elle est délibérément composée de morceaux similaires mais qui ne sont pas tout à fait identiques. Régulière, parce qu’elle se livre à une répétition des mêmes éléments, comme des triangles isocèles. Dans sa radicalité trigonométrique, The Blind Leading the Blind s’apparente aux inventions iconiques révolutionnaires contemporaines de Barnett Newman. D’où sa juxtaposition avec Uriel de 1955. La réduction de la peinture à la surface et à la couleur à laquelle se livre Newman trouve un écho dans la réduction de la sculpture de Louise Bourgeois à quelques formes trigonométriques de base, combinées entre elles. Mais elle peut aussi s’idenfier à un peigne, instrument de tapissier, omniprésent dans le travail de L.b

Est mise en regard de ce travail dans une vitrine, un oeuvre en tissu, faite de rondeurs grises, très connotée, arborant un sexe de couleur rose.
Bronze, patine dorée, pièce suspendue, 25,7 x 31,7 x 21,3 cm
Collection de l’artiste
Photo Christopher Burke
Dans la même année que Fillette, déjà vue à la Fondation, lors de l’exposition « Eros », Louise Bourgeois réalise d’autres œuvres suspendues qui sont des parties du corps humain à consonance sexuelle. Il s’agit d’une série de quatre sculptures de forme phallique, au titre évocateur de Janus parmi lesquelles Janus fleuri. Comme l’indique la référence à l’antique divinité latine, Janus, était le dieu à double visage, l’un tourné vers le passé et l’autre vers le futur, divinité des portes (janua), celles de son temple étaient fermées en temps de paix et ouvertes en temps de guerre. Tout s’ouvre ou se ferme selon sa volonté. C’est le côté bipolaire qui fascine l’artiste dans le choix du titre. « Janus fait référence à la polarité qui nous habite (…) la polarité dont je fais référence est une pulsion vers la violence extrême et la révolte (…) et le retrait », écrit l’artiste qui y voit aussi « un double masque facial, deux seins, deux genoux ».
Ici elle est mise en regard avec le nu couché jouant avec un chat de Picasso 1964
Passage Dangereux

Les représentations les plus impressionnantes peut-être que Louise Bourgeois a données de certains aspect de son Moi sont ses légendaires Cells, dont la plus grande, Passage Dangereux de 1997, est exposée dans le Souterrain de la Fondation Beyeler. L’artiste plaçait au tout premier plan les représentations de sentiments et d’émotions. Les nombreux objets du Passage Dangereux sont les symboles d’événements conscients et inconscients de son enfance et de sa puberté — dont la magie et les drames trouvent une mise en scène imagée dans une architecture créée à cette fin, et peuvent ainsi être dépassés.
Jerry Gorovoy, – voir la vidéo ici- une autre là présent vendredi et samedi, a été l’assistant de Louise Bourgeois pendant plus de trente ans. C’est un excellent connaisseur de son œuvre, qui a joué, comme elle l’a souvent rappelé, un rôle décisif dans la genèse de ses pièces. Aux yeux de Louise Bourgeois, un grand nombre de ses œuvres n’auraient pas vu le jour sans son aide. Son discours (en anglais) s’est concentré particulièrement sur l’importance de Louise Bourgeois comme artiste et comme modèle pour des générations d’artistes.
Les oeuvres ne sont pas nombreuses, mais très justement mises en adéquation avec le fonds de la Fondation Beyeler par le commissaire Ull Küster, auteur d’un livre sur Louise Bourgeois. (anglais-allemand) On peut déplorer qu’il n’existe pas de version française, surtout étant donnée la double nationalité de l’artiste (américaine et française).
Il a eu l’occasion de préparer cette exposition avec elle.
l’exposition est visible jusqu’au 8 janvier 2012
photos courtoisie de la Fondation Beyeler