« Je peins la lumière qui vient de tous les corps »
Egon Schiele.
Le musée Léopold de Vienne consacre une rétrospective à
Egon Schiele, pour commérer le centenaire de son décès.
Naissance le 12 juin 1890 , à Tulln an der Donau près de Vienne,
et mort le 31 octobre 1918 à Vienne.
Avec plus de 40 peintures et environ 180 œuvres sur papier,
le musée Léopold montre la plus grande et la plus importante
collection d’œuvres d’Egon Schiele dans le monde.
Lorsque Egon Schiele mourut en 1918, à l’âge de 28 ans seulement,
il fut considéré comme l’un des artistes les plus importants
de son époque. Au cours des années suivantes, il a été de plus
en plus oublié, jusqu’à ce qu’il disparaisse complètement,
après avoir été jugé comme « art dégénéré« .

Lorsque Rudolf Leopold a vu des œuvres d’Egon Schiele au
début des années 50, il a immédiatement reconnu que leur qualité,
leur émotivité et leur technicité pouvaient absolument être comparées
aux Old Masters. Rudolf Leopold a apporté une contribution
significative à l’estime internationale dans laquelle Schiele se trouve
aujourd’hui.
Schiele a connu une carrière aussi prolifique que fulgurante.
C’est une comète dans la Vienne inventive et hypocrite de cette fin
de siècle. Ses compagnons et amis peintres sont Klimt et Kokoschka.
Les quartiers pauvres sont un vivier pour ses modèles,
qu’il fait poser dans des situations lascives et indécentes.

Il a été emprisonné pour avoir peint des modèles à peine pubère.
Il a une aisance inouïe dans le dessin. D’un trait, d’une ligne, sans jamais
lever le crayon, qui semble fait sans repentir, il érige un corps.
Il a à la fois une qualité de synthèse de la forme et une justesse
de la physionomie. Il introduit une nudité essentielle du corps,
un trait qui devient une sorte d’exo-squelette (Philippe Dagen)
Il est assez proche de Rodin pour le dessin et les modèles.
Présence de très jeunes modèles qui s’exhibaient et prêtaient
leurs corps, en montrant leurs attributs sexuels, que l’artiste
reproduisait.
Il y a une point commun autre entre les deux artistes,
c’est l’aquarelle.
La couleur vient se poser sur les pubis, très souvent par taches
de rouge, pour se diffuser et se diluer.
Les corps qu’il représente sont un minimum de chair, maigre
squelettique, cadavérique, parfois inachevé, sans les pieds.
Une saisie de l’instantané, comme dans la photographie.
Il voit les peintres de la Sécession, dont Munch.
Il peint beaucoup d’autoportraits, mais aussi sa soeur,
premier modèle nu.
Un étrange écartement de la main, extrêmement présentes,
noueuses, souvent démesurées par rapport au corps.
De façon récurrente des mains masturbatoires, le corps
contorsionné, chorégraphié, un point de vue en surplomb,
des postures inconfortables, déséquilibrées, comme des insectes
cloués sur le papier.
(L’Hostie rouge, Eros ou Autoportrait se masturbant,
tous de la même année 1911)
Outre les peintures à l’huile et les œuvres graphiques, le musée
Léopold abrite également le centre de documentation Egon Schiele,
dédié à la recherche sur l’œuvre de Schiele, ainsi que de nombreux
autographes. Pour la première fois, l’œuvre lyrique de Schiele
apparaît à un public plus large.

Schiele poète
Alors que Schiele était très populaire pour ses peintures et ses dessins
de son vivant, son travail poétique a longtemps passé inaperçu, bien
que son lyrisme expressionniste soit en effet très important.
Les originaux des poèmes de Schiele appartiennent en grande partie
à la collection Léopold. De nombreuses lettres et poèmes étaient presque
conçus comme des œuvres d’art graphiques d‘Egon Schiele. Les sujets
sont similaires à ceux décrits dans ses peintures: ce sont des visions
personnelles avec la plus grande expressivité, la plus grande couleur
et la plus grande franchise.

Par exemple, Schiele veut « goûter les eaux sombres », « voir l’air sauvage »,
« construire des nuages blancs » ou créer « une mousse arc-en-ciel »,
des allées de course à pied « ou un » vent d’hiver « .
Son âme acharnée qui s’exprime dans son monde artistique éclate
aussi de manière éruptive dans son œuvre lyrique: «L’excès de vie»
et «l’agonie de penser» sont tout aussi présents que les forces obscures:
«les démons! – freiner la violence! – votre langue, – vos signes,
votre pouvoir! « , Proclame Egon Schiele.
La gamme de ses sentiments contradictoires culmine dans la
conclusion paradoxale et finale: « Tout est mort mortellement ».

Enfin, il faut souligner la part allégorique de l’œuvre de Schiele.
Les titres de certains tableaux (Agonie, Résurrection…) et certains
de ses propos abondent dans ce sens. Schiele affirmait le rôle
spirituel de l’art, il disait en 1911 que ses œuvres devraient être
exposées dans des « édifices semblables à des temples », et avait
pour projet, en 1917-1918, la construction d’un mausolée que
l’on croit dédié aux morts de la Grande Guerre.

Le célèbre tableau, La Famille (1918), affirme cette part allégorique :
Schiele se représente avec sa femme et son enfant, alors même qu’il
n’est pas encore père et ne le sera jamais, car lui, comme sa femme
enceinte, peu de temps avant, meurent de la grippe espagnole.
Ce tableau non achevé sera son dernier.

Schiele a fait près d’une centaine d’autoportraits
se représentant parfois nu, avec un visage desséché et
tourmenté, ou affligé d’un strabisme impressionnant, allusion
humoristique à son nom de famille : en effet, le verbe « schielen »
signifie loucher en allemand, et nombre de critiques hostiles
à son art n’hésitaient pas à en faire des jeux de mots.
Ses peintures provoquaient, et provoquent sans doute encore
les spectateurs, suscitant chez eux un certain malaise par leur
rapport à la mort et à l’érotisme, mais aussi par certaines
couleurs verdâtres de la décomposition.

Podcast sur France Culture
Alain Fleischer le dernier tableau de Schiele
(2008, éditions du Huitième jour).

L’Europe tient à célébrer l’artiste foudroyé à l’âge de 28 ans,
par la grippe espagnole, en faisant appel à leurs
fonds, aux collections privées etc …
Sa courte vie et l’œuvre sera marquée par le scandale.
Schiele a laissé environ trois cents peintures, dix-sept gravures
et lithographies, deux gravures sur bois, de nombreuses sculptures
et 3 000 dessins, aquarelles ou gouaches.
D’autres expositions lui sont ou seront consacrées
pour la célébration l’une, à la Fondation Vuitton,
des dessins, des gouaches et quelques peintures,(120)
une autre montrera ses dernières oeuvres au Musée des
Beaux Arts de Bruxelles, une autre encore à Londres
la Royal Academy, montrera ses dessins , ses
autoportraits, ses nus érotiques, en compagnie des
croquis de Klimt sur le projet de la Sécession.
Partager la publication "Egon Schiele, l'exposition du jubilé"

























 Sur place, elle déploie des gestes
Sur place, elle déploie des gestes 01 septembre 2018 :
01 septembre 2018 : 








 Il a su effectuer simultanément différentes techniques picturales
Il a su effectuer simultanément différentes techniques picturales

 Outre des peintures d’oiseaux et de fleurs riches en détails et
Outre des peintures d’oiseaux et de fleurs riches en détails et


 Issu d’une lignée de Samouraï, Rosetsu a suscité l’attention de
Issu d’une lignée de Samouraï, Rosetsu a suscité l’attention de Commissaires de l’exposition
Commissaires de l’exposition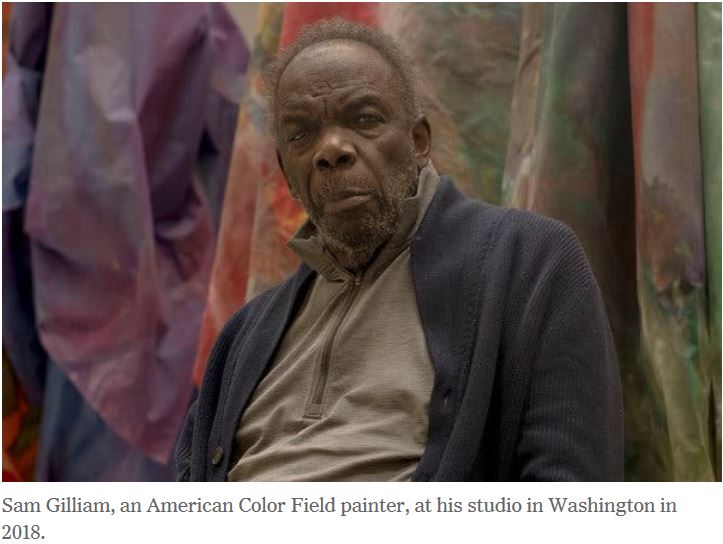







 Dans le cadre de l’exposition, la publication The Music of Color,
Dans le cadre de l’exposition, la publication The Music of Color,














