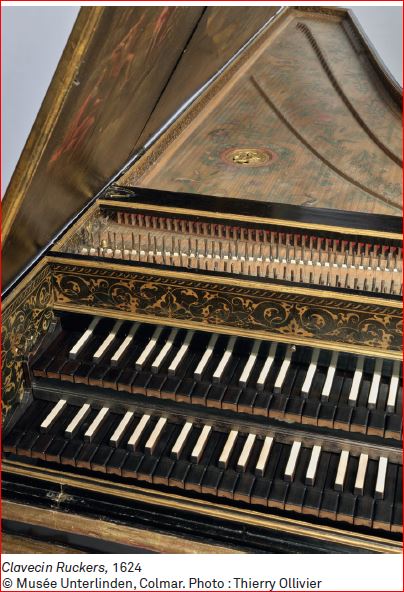Les Nuits de la lecture | Villes et campagnes
Déambulations – Théâtre
23 janvier 2026
(Re) découvrez les collections du musée dans un cadre privilégié, la nuit, à la lumière de textes, de poèmes et de dialogues sur le thème Villes et campagnes sélectionnés par les élèves du Cycle 3 à Orientation Professionnelle théâtre du Conservatoire de Colmar.
Publics | Dès 12 ans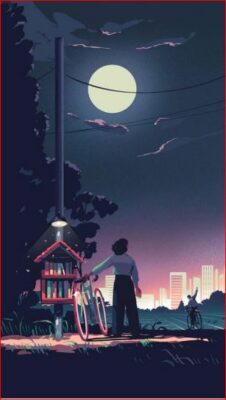
Date | 23.01.2026
Horaires | 19h et 20h30
Durée | 45 min
Tarif | Entrée gratuite (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre à la billetterie du musée
* Pour participer à l’événement, nous vous invitons
à réserver auprès du service réservations
du lundi au vendredi au +33 (0)3 89 20 22 79 – reservations@musee-unterlinden.com / le weekend au +33 (0)3 89 20 15 58 ou billetterie@musee-unterlinden.com
Visite – atelier
Visite écriture
Le 25.01.26 à 11h
Equipé de votre plus belle plume partez en voyage, entre villes et campagnes, à travers les collections du musée. Par le biais de petites expérimentations littéraires, appréhendez les œuvres de manière créative et tout en sensibilité.
Publics | Adultes
Date et horaire | 25.01.26 à 11h
Durée | 1h30
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre à la billetterie du Musée
* Pour participer à l’événement, réservations du lundi au vendredi au +33 (0)3 89 20 22 79 –
reservations@musee-unterlinden.com / le week-end au +33 (0)3 89 20 15 58 ou
billetterie@musee-unterlinden.com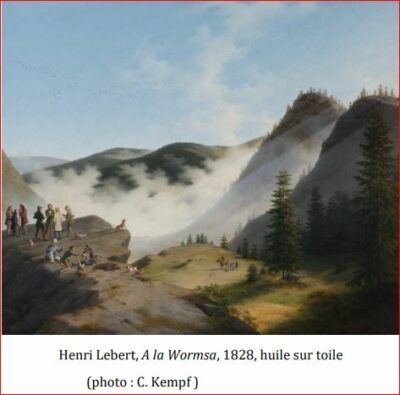
Atelier familles
Happy Family – Villes et campagnes
Le 25.01.26 à 14h
En compagnie de Dominique Zerlauth, intervenante en écriture, petits et grands sont invités à cueillir des mots, poser des phrases, construire de courts textes autour des collections du musée et sur le thème Villes et campagnes.
Date I 25.01.26
Publics I Familles, enfants dès 3 ans
Horaire I de 14h à 16h
Tarif I Entrée du musée (jauge limitée*)
Lieu I Point de rencontre à la billetterie du Musée
- Pour participer à l’événement, réservations du lundi au vendredi au +33 (0)3 89 20 22 79 –
reservations@musee-unterlinden.com / le week-end au +33 (0)3 89 20 15 58 ou
billetterie@musee-unterlinden.com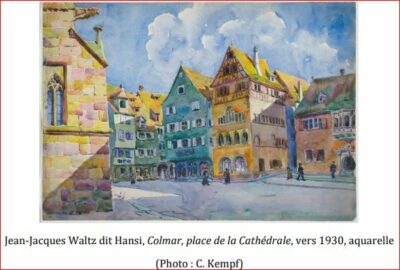
Visite du Retable d’Issenheim
Le 25.01.26 à 14 h
Le Retable d’Issenheim du peintre Grünewald et du sculpteur Nicolas de Haguenau est un chef d’œuvre mondialement reconnu. En compagnie d’une médiatrice, partez à la rencontre de ce polyptique monumental, composé d’une caisse sculptée et de volets peints dédiés à saint Antoine et à la vie du Christ.
Date et horaire | 25.01.26 à 14h
Durée | 1h30
Tarif | 4,50 € et droit d’entrée (jauge limitée*)
Lieu | Point de rencontre à la billetterie du Musée
* Pour participer à l’événement, réservation en ligne depuis le site internet ou auprès du service
réservations du lundi au vendredi au +33 (0)3 89 20 22 79 – reservations@museeunterlinden.com / le week-end au +33 (0)3 89 20 15 58 ou billetterie@musee-unterlinden.com
Visite nocturne à la lampe torche
Le 30.01.26 à 18h30
Venez vivre une expérience nocturne inédite au cœur des œuvres.
Nous vous invitons à pénétrer dans un musée endormi, plongé dans la pénombre, uniquement éclairé par le faisceau discret de votre lampe torche. Cette lumière intimiste vous guidera au fil d’un parcours sensoriel, propice à l’éveil des sens, à la curiosité et à l’émotion.
Accompagné d’un médiateur passionné, vous découvrirez les chefs-d’œuvre du musée – dont l’exceptionnel Retable d’Issenheim – sous un jour nouveau.
Jeux d’ombres et de lumières, détails insoupçonnés, récits oubliés ou méconnus… chaque salle devient un théâtre d’histoires et de sensations, hors du temps !
Tout public
Date I 30.01.26
Horaire I de 18h30 à 19 h30
Tarifs I 20€ pour les adultes et jeunes dès 12 ans ; 17€ pour les moins de 12 ans (jauge limitée*)
Lieu I Point de rencontre à la billetterie du musée
Réservation en ligne
https://my.weezevent.com/visite-nocturne-a-la-lampe-torche-2
* Pour participer à l’événement, vous pouvez également réserver auprès du service réservations
du lundi au vendredi au +33 (0)3 89 20 22 79 ou au comptoir de la billetterie du musée.
Informations pratiques
Musée Unterlinden
Place Unterlinden – 68000 Colmar
T. +33 (0)3 89 20 15 50
info@musee-unterlinden.com
www.musee-unterlinden.com
www.instagram.com/museeunterlinden
www.facebook.com/museeunterlinden
Horaires d’ouverture
Mercredi au lundi : 9h – 18h
Mardi : fermé
Fermé le 01.01, 01.05, 01.11, 25.12
Tarifs
Plein / 14 €, Réduit / 12 €
Jeunes (12 à 17 ans, étudiants de – de 30 ans) / 9 €
Familles / 36 €
Gratuit / moins de 12 ans
Pass-musées
Partager la publication "Les Nuits de la lecture – Villes et campagnes Déambulations – Théâtreau Musée Unterlinden"



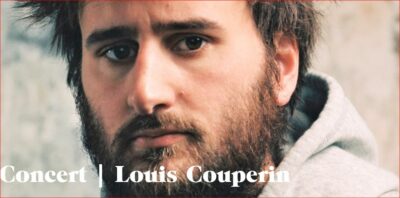
 À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Louis Couperin,
À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Louis Couperin, 



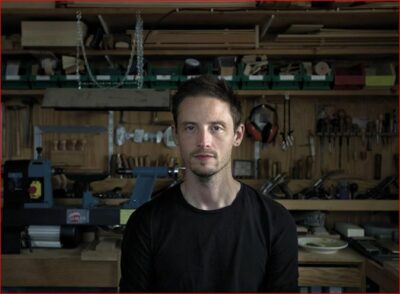








 Ils seront donnés dans la salle de la Piscine du Musée Unterlinden, une ancienne piscine municipale de 1905 réhabilitée par les architectes suisses Herzog & de Meuron. Les concerts réuniront des artistes qui ont particulièrement joué, enregistré et aimé le Ruckers de Colmar : Christophe Rousset, Jean Rondeau, Christine Schornsheim, mais aussi Blandine Verlet (1942-2018) au travers de deux clavecinistes qui ont été profondément marqués par son enseignement, Jean Rondeau et Jean-Luc Ho. La programmation des concerts permettra
Ils seront donnés dans la salle de la Piscine du Musée Unterlinden, une ancienne piscine municipale de 1905 réhabilitée par les architectes suisses Herzog & de Meuron. Les concerts réuniront des artistes qui ont particulièrement joué, enregistré et aimé le Ruckers de Colmar : Christophe Rousset, Jean Rondeau, Christine Schornsheim, mais aussi Blandine Verlet (1942-2018) au travers de deux clavecinistes qui ont été profondément marqués par son enseignement, Jean Rondeau et Jean-Luc Ho. La programmation des concerts permettra