Du 11 février au 13 juin, la CaixaForum de Madrid reçoit une rétrospective des 25 ans de trajectoire plastique de Miquel Barceló (Majorque, 1957),
Très influencé par l’art brut, Miquel Barceló a proposé une alternative singulière aux tendances dominantes de l’art contemporain. Tout d’abord, face à la rhétorique de l’abstrait, si habituelle et rebattue dans les années quatre-vingt, l’artiste de Majorque revendiquait l’expressivité du figuratif. Ensuite, face aux discours conceptuels complexes, très à la mode dans les années quatre-vingt-dix, son œuvre a su rester fidèle aux principes du travail manuel et n’a jamais perdu son intérêt pour les textures, les couleurs et les formes de la matière. Il est un représentant incontournable de l’art espagnol, le plus international et apprécié du moment. Le spectateur peut découvrir sa riche expérience artistique, chargée en mystère et en adrénaline. Au total, ce sont plus de 200 œuvres à parcourir : peintures, sculptures, affiches, livres et carnets de voyage…
Pour l’évènement, l’artiste prête au centre social et culturel de la Obra Social « La Caixa », une de ses meilleures sculptures, El Gran Elefant Dret (2009). Un éléphant en bronze de sept mètres de haut, installé sur la place publique qui donne accès à la Caixa Forum.
Cette exposition inédite permet d’apprécier sa foisonnante biographie artistique qui s’étend de 1982 à nos jours, ne résiste pas à un passionnant voyage parmi ses vastes toiles. Le spectateur semble envoûté par le rythme trépidant, énigmatique et mystérieux de l’œuvre de Barceló.
 Une salle en retrait, plongée dans une semi-obscurité, une chapelle toute de mystère et de recueillement, est particulièrement émouvante, une crucifixion, des sculptures de crânes d’animaux, des toiles en presque noir et blanc, des toiles ocres, que vous pouvez retrouver sur la vidéo du vernissage.
Une salle en retrait, plongée dans une semi-obscurité, une chapelle toute de mystère et de recueillement, est particulièrement émouvante, une crucifixion, des sculptures de crânes d’animaux, des toiles en presque noir et blanc, des toiles ocres, que vous pouvez retrouver sur la vidéo du vernissage.
Le gorille blanc sur la plage, 1999 était sous une autre forme à la Biennale de Venise, tragique dans sa solitude, tracé à grands coups de couteau, visage à la bouche hurlante d’effroi, les bras en croix, sur fond d’océan écumeux.
Ses autoportraits, sont saisissants, surtout celui où l’aspect « animal-fou / loup garou » est terrible.
Dans son catalogue, les œuvres voisinent, avec d’autres qu’il cite en référence, qui l’ont inspirée, tel que le Paysage pour aveugles sur fond vert II.1989 ,il cite Ribera, Richter, Tanguy, Richard Long
L’objectif de l’exposition est d’offrir au grand public l’occasion de vivre l’art de Barceló comme une véritable expérience personnelle. Ainsi, il a choisi lui-même les toiles et les sculptures qu’il jugeait les plus représentatives de sa carrière artistique, quelques-unes venant de sa collection privée.
J’ai été émerveillée, par sa série d’aquarelles de Sangha, vendeuses de tomates un jour venteux, 2000. ou encore Le vent, 1999 où le rouge tragique d’un personnage, de sa barque renvoie à Turner ou à la barque de Dante de Delacroix. Des présentoirs sont consacrés aux aquarelles.
Mais aussi de nombreuses toiles montrent la série des Dogons, déjà vues à Venise, déserts de sables jaunes, bleus avec des personnages anonymes et des troupeaux cheminant.
Une peinture pour aveugles en relief, sur fond vert, que les gardiens vous empêchent de toucher ……
D’autres toiles consacrées à la corrida, à la cuisine espagnole, un moment idéal pour se pencher sur la production artistique de Miquel Barcelo.
C’est une occasion spéciale pour le public, qui aura l’opportunité de s’aventurer dans son monde matériel, dans ses voyages physiques ou mentaux dans l’espace-temps, dans son utilisation d’éléments insolites, dans sa représentation du monde humain et animal, et dans son rapport à la tradition. Le catalogue en espagnol et en anglais est tout à fait abordable 20 €.

les photos sont interdites, aussi je vous présente les scans du catalogue
Partager la publication "Miquel Barcelo – Caixaforum de Madrid"









 Un peintre
Un peintre  Et enfin celle que vous attendez tous la pétulante
Et enfin celle que vous attendez tous la pétulante 







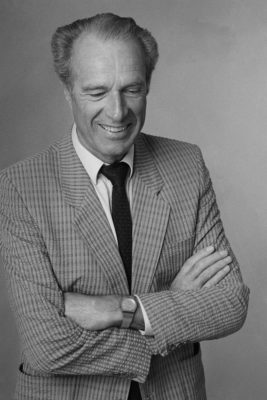


 Aurélien. Venu à Rome sur l’invitation du philosophe Craton, qui avait appris ses dons de Thaumaturge, Valentin guérit son fils à la condition que toute sa famille se convertit. A cause de quoi il fut d’abord emprisonné, puis, refusant de sacrifier aux idoles, roué de coups et enfin décapité. Son corps fut recueilli par ses disciples et emporté à Terni, sur la via Flaminia.
Aurélien. Venu à Rome sur l’invitation du philosophe Craton, qui avait appris ses dons de Thaumaturge, Valentin guérit son fils à la condition que toute sa famille se convertit. A cause de quoi il fut d’abord emprisonné, puis, refusant de sacrifier aux idoles, roué de coups et enfin décapité. Son corps fut recueilli par ses disciples et emporté à Terni, sur la via Flaminia. Dans l’Ecclésiaste le mot vanité est utilisé dans son acception plus ancienne et plus littéraire de « ce qui est vain », c’est-à-dire futile, illusoire, vide, de peu d’impact, voire sans aucune réalité. Tout avantage possible de la vie est anéanti par l’inéluctabilité de la mort.
Dans l’Ecclésiaste le mot vanité est utilisé dans son acception plus ancienne et plus littéraire de « ce qui est vain », c’est-à-dire futile, illusoire, vide, de peu d’impact, voire sans aucune réalité. Tout avantage possible de la vie est anéanti par l’inéluctabilité de la mort. collaborateurs, à l’importante exposition qui se tient au musée Maillol jusqu’au 28 juin.
collaborateurs, à l’importante exposition qui se tient au musée Maillol jusqu’au 28 juin. 
 Un véritable parcours à travers les disciplines et les époques successives, aux prises avec des interrogations différentes. Du memento mori, réflexions sur la fragilité de la vie et le temps qui passe, Vanité ou Allégorie de la vie humaine de La Madeleine pénitente (copie) de Georges de La Tour aux mouches de Damien Hirst ou aux vers des frères Chapman, Étranges, dérangeants, voire effrayants, ne sont pas simplement des oeuvres d’art, mais aussi des chefs-d’oeuvre techniques, dotés d’une vraie portée philosophique ou intellectuelle. Je ne peux que vous encourager à vous y plonger, mon enthousiasme provient de mon côté « morbide »… car dans le monde Philippe Dagen n’est pas très enchanté de cette exposition, vous pouvez lire son article dans les commentaires, évidement le monde des blogueurs lui emboîte le pas !
Un véritable parcours à travers les disciplines et les époques successives, aux prises avec des interrogations différentes. Du memento mori, réflexions sur la fragilité de la vie et le temps qui passe, Vanité ou Allégorie de la vie humaine de La Madeleine pénitente (copie) de Georges de La Tour aux mouches de Damien Hirst ou aux vers des frères Chapman, Étranges, dérangeants, voire effrayants, ne sont pas simplement des oeuvres d’art, mais aussi des chefs-d’oeuvre techniques, dotés d’une vraie portée philosophique ou intellectuelle. Je ne peux que vous encourager à vous y plonger, mon enthousiasme provient de mon côté « morbide »… car dans le monde Philippe Dagen n’est pas très enchanté de cette exposition, vous pouvez lire son article dans les commentaires, évidement le monde des blogueurs lui emboîte le pas !