Maurizio Cattelan, Spermini, 1997 Masques en latex peints, 17,5 x9 x 10 cm (chacun) Courtesy Maurizio Cattelan’s Archive
Au Centre Pompidou Metz, jusqu'au 1er février 2027 -
Grande Nef, Galerie 1, Forum et toits des Galeries
Commissaires : Maurizio Cattelan, Chiara Parisi, directrice du Centre
Pompidou-Metz, et l’équipe du pôle Programmation du Centre Pompidou-Metz
– Sophie Bernal, Elia Biezunski, Anne Horvath, Laureen Picaut et Zoe Stillpass, accompagnées par Marta Papini.
Un dimanche sans fin. Un temps suspendu entre loisir et révolte. Pour célébrer ses 15 ans, le Centre PompidouMetz invite le public à une plongée vertigineuse
dans l’histoire de l’art à travers Dimanche sans fin, une exposition hors normes qui investit l’ensemble du musée. Près 400 pièces issues des collections du
Centre Pompidou rencontrent le regard implacable de Maurizio Cattelan, dont 40 de ses œuvres interrogent nos mythologies modernes avec lucidité et mélancolie.

Dès l’entrée, le visiteur est confronté à une mise en scène de l’autorité
et de sa contestation. Ici, les textes de salle sont porteurs d’une parole
incarnée : celle de Maurizio Cattelan et des détenues de l’Institut de
réclusion pour femmes de la Giudecca-Venise, qui explorent ensemble
la notion de liberté sous la forme d’un abécédaire. En salle, des détenus
formés à la médiation issus du Centre pénitentiaire de Metz accompagnent
ponctuellement les groupes.
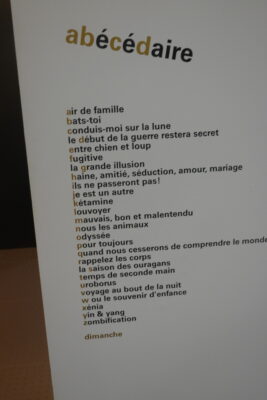
Au fil d’un parcours construit comme un abécédaire, l’exposition alterne
œuvres iconiques, pièces inattendues et dialogues transhistoriques. La
scénographie immersive de Berger&Berger transforme le musée en une
déambulation circulaire, faisant écho aux cycles du temps et à l’architecture
de Shigeru Ban et Jean de Gastines.
Loin d’un catalogue classique, le livre de l’exposition conçu par Irma Boom
pousse encore plus loin la réflexion. Maurizio Cattelan y livre un regard
singulier sur son propre travail et sur son histoire personnelle. Plus qu’un
recueil, une autobiographie.
Que signifie un dimanche sans fin ? Un jour qui s’étire entre liberté et
contrainte, mémoire et projection, errance et engagement. Avec cette
exposition, le Centre Pompidou-Metz propose un labyrinthe de récits où
l’art, en dialogue avec le réel, continue d’ouvrir des brèches dans notre
perception du monde.
Quinze après son exposition inaugurale Chefs-d’œuvre ? (2010), à l’occasion
de laquelle le Centre Pompidou-Metz questionnait notamment les acquis de
l’histoire de l’art, l’institution poursuit son exploration du regard porté sur
les œuvres et de la notion de collection. Cette réflexion trouve son point
d’orgue avec Dimanche sans fin. Maurizio Cattelan et la collection du Centre
Pompidou, une exposition d’envergure célébrant à la fois le 15e
anniversaire du Centre Pompidou-Metz et son dialogue fécond avec le Centre Pompidou, en pleine métamorphose.
Une perspective nouvelle sur une collection d’exception
Se déployant dans tout le musée, du Forum à la Grande Nef, de la Galerie 1
aux toits des Galeries transformés pour la première fois en jardin de
sculptures, l’exposition rassemble plus de 400 œuvres issues des différents
départements du Musée national d’art moderne, qui rencontrent trente
œuvres de Maurizio Cattelan. Artiste de renommée internationale et
co-commissaire invité, il pose son regard incisif sur la collection, offrant un
jeu de correspondances inattendues.
Artiste majeur de la création contemporaine, Maurizio Cattelan insuffle à
l’exposition une approche incisive et décalée, et porte par sa présence un
regard neuf sur cette prestigieuse collection. Sa pensée, mélancolique
et ironique, traverse les contradictions sociétales, déjoue les structures
d’autorité et interroge les systèmes de croyance. Son univers qui frappe
depuis les années 1990 entre subversion et engagement, révèle notre monde
en mutation.
Le dimanche : entre rituels, loisirs et révolte
Dans de nombreuses cultures anciennes, le dimanche – dies solis chez les
Romains – est associé au soleil et à son culte. En 321 après J.-C., l’empereur
Constantin en fait un jour de repos et de prière dans tout l’Empire romain.
Au fil des siècles, sa signification évolue, et du temps sacré au temps libre,
le dimanche devient au XXe siècle le jour des loisirs, du sport et plus
récemment de la consommation. C’est aussi celui où l’on flâne dans un parc,
visite un musée, paresse chez soi ou partage un repas en famille, en gardant
à l’esprit la musique en sourdine de la révolte, du soulèvement qui peut
surgir à tout moment. Traversé par cette complexité, le parcours de
l’exposition oscille entre tendresse et culpabilité, pointant les impasses de
nos époques, pour mieux spéculer sur des lendemains alternatifs.
Traditionnellement associé au repos et à la contemplation, le dimanche est
un jour paradoxal. De jour sacré à celui des loisirs et de la consommation,
il résume à lui seul les mutations de nos sociétés. L’exposition en explore
les différentes facettes à travers un parcours thématisé en forme
d’abécédaire, clin d’œil à Gilles Deleuze. Chaque section, intitulée
d’après un poème, un film, un roman (A pour « Air de famille », B pour
« Bats-toi », C pour « Conduis-moi sur la lune », etc.) autant d’invitations
à revisiter les idées associées au dimanche et à s’immerger dans
l’univers complexe et torturé de Maurizio Cattelan, qui guide le visiteur
dans une exploration transhistorique et sensorielle.
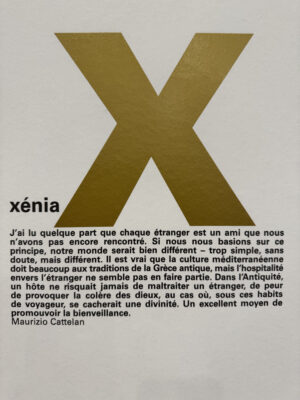
Une immersion architecturale et scénographique
Parmi les 26 lettres de l’alphabet, auxquelles s’ajoute une 27e
entrée, celle dédiée à la section « Dimanche », et qui forment autant de chapitres, les visiteurs déambulent librement dans un parcours conçu par les scénographes Berger&Berger. Une grande dérive dans l’histoire de l’art jouant
d’associations étonnantes à tous les étages du musée.
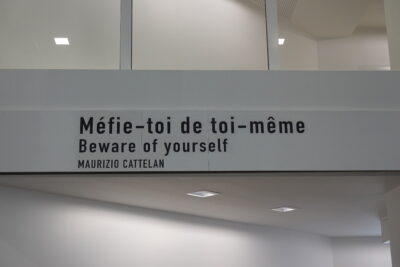
La mise en espace joue sur les formes et les cycles. En écho à l’architecture
hexagonale de Shigeru Ban et Jean de Gastines, le parcours s’organise
autour d’une circulation giratoire dans la Grande Nef et de cercles
concentriques en Galerie 1, ponctués de lignes droites qui structurent
la déambulation.
L’exposition se déploie sur plusieurs niveaux, proposant un voyage dans
l’histoire de l’art et ses ruptures. Dans le Forum, la monumentalité de
L.O.V.E., sculpture iconique de Cattelan représentant une main amputée
de ses doigts, ne laissant que le majeur tendu, instaure un face à face direct
avec le visiteur dès ses premiers pas dans le musée. Cet anti-monument
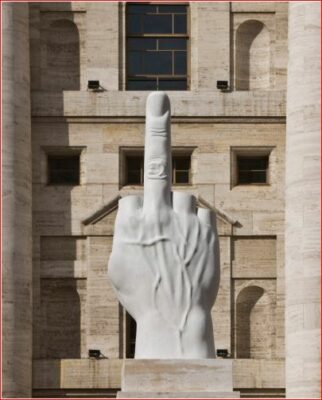 soulève des questions autour des relations de pouvoir et de croyances qui
soulève des questions autour des relations de pouvoir et de croyances qui
se jouent dans l’espace public.
Dans la Grande Nef, le serpent « Uroborus », figure du cycle infini, ouvre
l’exposition et donne son rythme au parcours, où dialoguent objets rituels,
artefacts anonymes et œuvres contemporaines. Les disques Pî chinois,
parures funéraires évoquant l’infini, croisent le Vieux Serpent de Meret
Oppenheim,  symbole à la fois d’origine et de dénouement. Felix de Maurizio
symbole à la fois d’origine et de dénouement. Felix de Maurizio
Cattelan, son gigantesque squelette de chat à l’échelle d’un dinosaure, remet
en question les classifications institutionnelles et les notions de fiction et
de réalité.
 Il envahit la section « Dimanche » où des œuvres majeures
Il envahit la section « Dimanche » où des œuvres majeures
comme Le Bal Bullier de Sonia Delaunay nous révèlent la polysémie
du concept de cette journée. Ses couleurs vives et chaudes, comme baignées
de lumière, répondent à celle de Last Light de Felix Gonzalez-Torres, une
guirlande lumineuse de 24 ampoules correspondant aux heures de la journée
représentant le passage du temps, un cycle fragile en mémoire des victimes
du SIDA.

En Galerie 1, le dimanche devient le théâtre des tensions politiques
et artistiques : « Ils ne passeront pas » présente des œuvres révélant
les traumatismes de l’après-guerre, à l’instar de Souvenirs de la galerie
des glaces à Bruxelles d’Otto Dix, ou capturant la violence d’un combat
physique, avec Les Lutteurs de Natalia Gontcharova.

D’autres œuvres marquent l’esprit transgressif et les ruptures radicales
opérées par les avant-gardes : Le Grand Nu de Georges Braque explore
les limites de la perception cubiste, le Carré noir de Kasimir Malévitch
pousse l’abstraction jusqu’à son essence la plus pure et la Tête Dada de
Sophie Taeuber-Arp brosse le portrait de la révolution dadaïste dans un
geste résolument anti-autoritaire.
 Georges Braque, Grand Nu, 1907-1908
Georges Braque, Grand Nu, 1907-1908
Huile sur toile, 140 x 100 cm
Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, AM 2002-127
© Adagp, Paris, 2025
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/Dist. GrandPalaisRmn





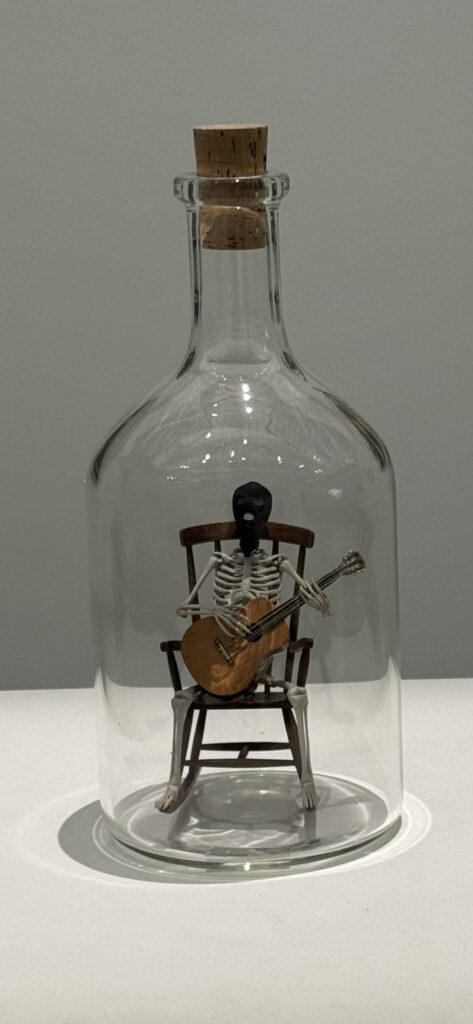



Renseignements Pratiques
OUVERTURE
Tous les jours, sauf le mardi et le 1er mai
HORAIRES
Du 1er novembre au 31 mars
Lundi → dimanche : 10:00-18:00
Du 1er avril au 31 octobre
Lundi → jeudi : 10:00-18:00
Vendredi → dimanche : 10:00-19:00
Partager la publication "Un dimanche sans fin-Maurizio Cattelan et la collection du Centre Pompidou"

